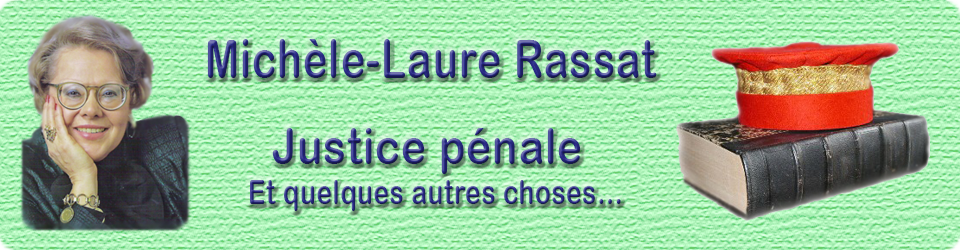La condamnation du Président Sarkozy suivie de son incarcération, en vertu d’une décision d’exécution provisoire de la condamnation prononcée, a soulevé une grande vague de réactions. La plupart de celles-ci a été de nature politique ou morale, sans compter de nombreux rassemblements pacifiques. Il y a eu aussi des réactions juridiques sur lesquelles il y a beaucoup à dire. La plus invraisemblable a été celle de plusieurs personnes, dont des parlementaires (ce qui n’est pas sans inquiéter s’agissant de membres du pouvoir législatif), demandant au Président de la République de gracier Nicolas Sarkozy. Il est regrettable de s’exprimer sur cette question quand on ignore que la grâce présidentielle ne peut concerner qu’une condamnation définitive ce que n’est pas celle de Nicolas Sarkozy puisqu’il a fait appel.
Il était donc nécessaire de laisser l’émotion retomber pour avoir une chance d’être entendu sur la valeur juridique et purement juridique de ce jugement car telle est la question.
Le jugement de la Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris soulève des questions de droit tant sur le droit pénal de fond que sur la procédure pénale.
I . Sur le fond du droit, la décision appelle un commentaire sur la qualification retenue et sur la peine appliquée.
Qualification retenue.
Initialement, Nicolas Sarkozy était poursuivi pour avoir tenté d’obtenir du dictateur Libyen Mouammar Kadhafi des fonds en vue de la campagne pour l’élection présidentielle de 2007. La poursuite retenait les tentatives de financement illégal de campagne électorale et de corruption et le recel de détournement de fonds publics.
Le Tribunal commence par relaxer Nicolas Sarkozy de l’ensemble de cette poursuite car il estime ne pas en trouver de preuves suffisantes.
La culpabilité de Nicolas Sarkozy était appuyée par une note datant de 2006, adressée par le chef des services extérieurs libyens au directeur de cabinet de Kadhafi et faisant état d’un accord de principe pour que la Libye finance la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy et par de nombreux témoignages émanant tant de libyens que d’intermédiaires dont le fameux Ziad Takieddine
La note a été publiée par Médiapart le 28 avril 2012 (entre les deux tours de l’élection présidentielle). Le Tribunal judiciaire de Paris déclare aujourd’hui qu’il s’agit « probablement d’un faux » et n’étant pas saisi de la question, il ne peut pas en dire plus. Pour autant cela n’est pas en contradiction avec la décision rendue par la Cour de cassation en 2019 et par laquelle elle avait validé l’analyse des juges du fond dans le jugement rendu sur constitution de partie civile pour faux de Nicolas Sarkozy contre Médiapart. Ces juges avaient, en effet, estimé qu’ils ne voyaient, dans le document figurant à la procédure ni « un support fabriqué par montage » ni des « falsifications ». Autrement dit le jugement sur le faux prétendu de Médiapart s’est basé sur un document papier et s’est focalisé sur un examen de faux matériel qui n’a pas été trouvé. Ce faisant il semble qu’il se fonde sur une erreur de fait puisqu’il s’avère que les magistrats ont été saisis d’un document qui était un tirage papier mais que le « vrai » document, si tant est qu’il ait existé, était un fichier informatique. L’examen de son authenticité devait donc concerner non pas un faux matériel mais un faux intellectuel : rechercher si le document disait vrai ou non ce sur quoi répond aujourd’hui le Tribunal judiciaire de Paris mais qui ne figure pas dans la procédure Mediapart.
Quant aux témoignages, nombreux, y compris celui de la personne qui aurait été l’auteur de la note, ils se caractérisent tous, soit par leur imprécision soit par leurs contradictions, y compris internes.
Mais après avoir relaxé Nicolas Sarkozy des infractions principales, le Tribunal le condamne cependant pour association de malfaiteurs, avec des proches, en vue de commettre les infractions en question.
La quasi-totalité des commentateurs a dit que l’infraction d’association de malfaiteurs était une qualification à tout faire qui permettrait de condamner n’importe qui, pour n’importe quoi, commis dans n’importe quelles conditions. Cela n’est pas exact.
Il est vrai que dans notre droit, l’association de malfaiteurs est une infraction atypique puisqu’elle a pour but de pallier le principe du droit français de ne pas incriminer, au titre de la tentative d’infraction, les actes préparatoires à celle-ci mais seulement ceux qui constituent un commencement d’exécution. À défaut de renoncer à cette règle, qui a sa valeur, le législateur a songé à incriminer cette préparation à titre d’infraction autonome au moins lorsqu’elle associe plusieurs personnes. C’est ce que fait l’article 450-1 du Code pénal : « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement …».
Il est vrai aussi que les éléments matériel et moral de l’infraction sont particuliers en ce que le premier est moins précis qu’il ne l’est pour d’autres infractions et que les deux sont plus étroitement liés que d’habitude. Mais il est faux de soutenir qu’on peut les appliquer à n’importe quoi.
L’élément matériel de l’infraction suppose une « préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ». Cette condition est évidement remplie lorsque la préparation des infractions envisagées s’est matérialisée par le rassemblement, l’accumulation ou la préparation d’objets, ce qui ne peut s’appliquer à l’Affaire Nicolas Sarkozy. Mais l’incrimination est encore constituée lorsque les différents membres du groupement ont opéré ensemble ou séparément des déplacements ou des repérages, se sont rencontrés, ont distribué des rôles dans les opérations à venir en présentiel ou à distance (mail, SMS ou webcam) pour organiser la préparation de l’infraction envisagée. Il est certain, dans notre affaire, que les différents mis en cause se sont rencontrés quasi quotidiennement avec Nicolas Sarkozy puisque l’un (Claude Guéant) était directeur de son cabinet ministériel et que l’autre (Brice Hortefeux) était secrétaire général du parti politique au nom duquel Nicolas Sarkozy allait se présenter à l’élection présidentielle. Et il est encore établi qu’ils se sont rendus tous les trois en Libye à l’occasion d’un voyage officiel du ministre. Mais encore faudrait-il qu’à l’occasion de ces rencontres ou déplacements ils aient envisagé un éventuel financement libyen de la future campagne électorale de Nicolas Sarkozy entre eux ou avec Mouammar Kadhafi. Or il n’y a pas plus de preuves de cela qu’il n’y en avait de la tentative des infractions principales. Le Tribunal s’interroge longuement sur les détails de la visite en Libye pour conclure que rien de la distingue des visites extérieures habituelles d’un ministre. Il s’interroge même sur les relations de la France et de la Libye après l’élection de Nicolas Sarkozy pour savoir s’il y aurait la trace d’une quelconque forme de reconnaissance, qui pourrait faire croire à des relations privilégiées, avant de conclure qu’« elles ne paraissent pas… d’une nature et d’une intensité différentes de ce qui s’est pratiqué dans d’autres pays ».
Quant à l’élément moral de l’association de malfaiteurs, il est évidemment intentionnel et l’infraction ne peut être retenue que si chaque participant connaissait la nature du groupement dont il faisait partie et entendait s’associer à son action (comportements dépourvus d’équivoque). Or le Tribunal se contente d’affirmer que Nicolas Sarkozy « ne pouvait ignorer » ce que faisaient ses collaborateurs. Non seulement il ne retient pas un élément intentionnel, ni même une imprudence, mais seulement un désintérêt qui n’est que très exceptionnellement envisagé dans notre droit (non-assistance à personne en péril).
L’infraction d’association de malfaiteurs n’était donc pas plus susceptible d’être retenue contre Nicolas Sarkozy que toutes les autres.
Peine prononcée
Nicolas Sarkozy est condamné à cinq ans d’emprisonnement, une amende de 100.000 euros, une interdiction des fonctions publiques et une privation du droit d’éligibilité. Ces peines sont toutes dans les limites de ce qui est prévu par les textes d’incrimination mais la question est de savoir si elles correspondent aux principes généraux de nécessité et de proportionnalité des peines qui doivent présider à la décision du juge. Pour sévères qu’elles soient, les peines extra-carcérales ne sont pas discutables dans leur principe : elles répondent à l’idée générale, déjà exprimée par Montesquieu, que le peine doit correspondre l’infraction sanctionnée. Il en va autrement de la peine d’emprisonnement surtout aussi longue et prononcée ferme. Le Tribunal l’a justifiée par « l’exceptionnelle gravité (des faits) de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent …mais aussi dans les institutions même de la République ». On peut avoir des doutes très sérieux sur la validité de cette appréciation lorsqu’on connait les peines infiniment plus légères, souvent affectée du sursis et/ou d’un aménagement qui sont aujourd’hui prononcées pour de graves infractions de violence contre les personnes. Quant au risque d’entraver le jugement des citoyens-électeurs, il y a déjà été répondu puisque l’Affaire ayant éclaté entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy n’a pas été réélu.
II . Sur la procédure pénale, il se pose deux questions.
Compétence du Tribunal judiciaire de Paris.
La défense de Nicolas Sarkozy a soutenu l’idée que les faits qui étaient reprochés à leur client ayant été commis (s’ils l’avaient été) alors que celui-ci était ministre, seule La Cour de Justice de la République était compétente pour en juger. Le refus de tenir compte de cet argument est le seul point, à notre avis, sur lequel le Tribunal a raison. La compétence de la Cour de Justice de la République ne s’applique pas à tout crime ou délit commis par un ministre mais seulement à ceux qui ont « un lien direct avec les affaires de l’Etat ». Ce n’est pas le cas si le ministre n’a en vue que son intérêt personnel de candidat à l’élection présidentielle. Il n’est pas alors ministre mais simple citoyen. Il relevait de la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire.
Incarcération de Nicolas Sarkozy
Le prononcé d’un mandat de dépôt et l’exécution provisoire de la décision sont justifiés par le Tribunal au nom de « l’exceptionnelle gravité des faits » et du « quantum prononcé ». Or dans le cadre du prononcé de la peine, le premier point (gravité des faits) est celui qui a été utilisé pour justifier le second (nature et quantum de la peine). Cette motivation relève du serpent qui se mord la queue : le Tribunal semble en panne, il bégaie. Mais surtout, le Tribunal ne peut ignorer que sa décision ne sera pas exécutée comme une décision de condamnation, mais comme une détention provisoire puisque Nicolas Sarkozy ayant fait appel, la décision de première instance n’a pas l’autorité de la chose jugée. Et la meilleure preuve que leTribunal le sait est sa phrase selon laquelle l’exécution provisoire est une « mesure indispensable pour garantir l’efficacité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction ». On peut d’abord remarquer que si quelque chose a troublé l’ordre public, c’est davantage la condamnation à l’emprisonnement de Nicolas Sarkozy que l’infraction (au surplus inexistante). On peut ajouter que si le Tribunal souhaitait vraiment que la détention soit exécutée, il aurait dû motiver la décision d’exécution provisoire, sans le dire expressément, mais par les motifs qui permettent de placer en détention provisoire ou de la prolonger et qui sont énumérés par l’article 144 du Code de procédure pénale (protection des preuves – 1° à 3° de l’art. 144 ; protection de l’intéressé – 4° – ; Obstacle au renouvellement de l’infraction et à la fuite de la personne poursuive – 5° et 6° – ) . Or il ne le fait pas et le seul motif invoqué est encore le trouble à l’ordre public (7° de l’art. 144) alors que celui-ci n’est pas applicable à la détention provisoire en matière correctionnelle. Et s’il ne le fait pas, c’est parce que ces motifs n’existent pas. La poursuite ou le renouvellement de l’infraction ne sont pas possibles et l’atteinte aux preuves dix-huit ans après les faits non plus. On ne peut pas dire que le placement en détention protège Nicolas Sarkozy alors que les derniers jours ont montré que c’est le fait d’être en détention qui lui fait courir des risques au point d’avoir dû installer deux policiers armés (en contradiction avec les principes pénitentiaires) dans une cellule voisine de la sienne. Quant à la fuite de Nicolas Sarkozy, on l’imagine mal quitter la France déguisé ou caché dans un container ou un coffre de voiture.
Le Tribunal ne pouvait donc ignorer que l’emprisonnement de Nicolas Sarkozy ne devrait probablement pas se poursuivre très longtemps et surement, quoiqu’il arrive, pas pendant cinq ans. Et l’on en arrive à la conclusion qu’en prononçant l’exécution provisoire de sa décision le Tribunal a voulu s’offrir la joie d’assister à une entrée de Nicolas Sarkozy en prison. Mais nous avons dit que nous ne parlerions que de droit…