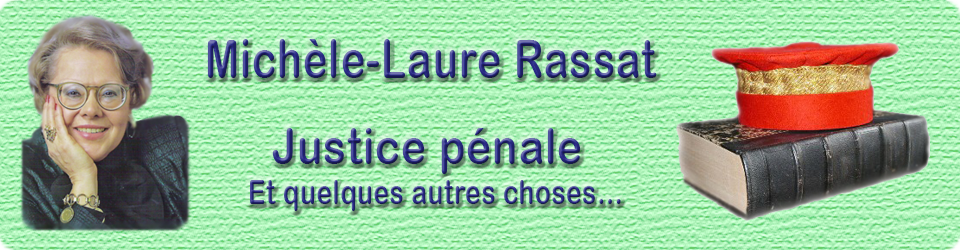On apprend que Messieurs Benalla et Crase viennent d’être incarcérés pour non-respect du contrôle judiciaire qui leur avait interdit de se rencontrer, sur la base de l’enregistrement d’une conversation qu’ils auraient eue lors d’une rencontre qui leur était interdite.
Au regard des règles du droit, cet enregistrement ne peut être qualifié autrement que de «sauvage » dans la mesure où il n’a été réalisé, ni sur demande de l’autorité judiciaire, ni sur celle de l’autorité administrative dans les cas où elle aurait été autorisée à le faire. A proprement parler, d’ailleurs, on ignore tout des conditions dans lesquelles ledit enregistrement a été réalisé, de son lieu, de son auteur et du cheminement qu’il a bien pu parcourir pour parvenir dans un media bien connu pour être spécialisé dans ce genre de collecte et qui l’a diffusé.
On comprend donc que les défenseurs des deux mis en examen soutiennent la nullité de la procédure qui a admis, comme preuve du manquement sanctionné, le dit enregistrement.
Pour autant, on ne peut, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, que douter qu’ils puissent réussir malgré la critique doctrinale pratiquement unanime dont cette jurisprudence fait l’objet depuis des années.
On aurait évidemment préféré que la question fut posée à propos de personnages plus sympathiques que ceux ici concernés, mais c’est tout de même assez fréquent en droit pénal et le droit est le droit et ne dépend pas de ceux à qui on l’applique.
Si, sauf cas particuliers, tous les modes de preuve sont admissibles en procédure pénale, il est également vrai qu’on ne peut ni obtenir, ni produire n’importe comment des éléments de conviction. Chacun d’eux répond à des procédures précises de récolement et de production que l’on traduit en parlant de la légalité et de la loyauté de la preuve. De cela il se déduit logiquement que doivent être repoussées les preuves obtenues par des procédés déloyaux comme les perquisitions illégales, les pièces issues de la commission d’une infraction pénale, l’intervention d’agents publics sous une fausse identité…ou les sonorisations ou enregistrements sauvages de conversations.
Malheureusement et depuis toujours, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les règles de loyauté ne concernent que les agents publics et ne s’imposent donc pas aux simples particuliers. Elle admet, en conséquence, le dépôt au procès pénal, par des parties civiles ou de simples témoins, de tous éléments de conviction sans tenir compte du moment de leur obtention (avant les faits ou durant la procédure) ou du moyen utilisé (ils peuvent avoir été acquis par une infraction pénale, même éventuellement sanctionnée comme telles – vol de documents – ). Ce faisant, la jurisprudence consacre, au profit des simples particuliers, un pouvoir d’investigation exempt de toutes règles et contraintes, sans la moindre justification. Rappelons que dans cet ordre d’idées on a récemment estimé convenable le jugement en France d’une personne que la partie civile avait fait arrêter et détenir illégalement depuis l’étranger par des hommes de main alors qu’un jugement en France ne peut intervenir, à l’initiative des pouvoirs publics, que si le prévenu ou l’accusé est venu ou revenu spontanément dans le pays ou a été remis au résultat de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ou d’une procédure d’extradition.
Les conséquences de cette jurisprudence sont regrettables d’abord sur le terrain de la fiabilité de la preuve car on ne peut avoir aucune garantie sérieuse sur la qualité, le lieu exact d’appréhension ou encore la consistance réelle de ce qui est apporté par des particuliers pour servir de preuve et qui a parfaitement pu être fabriqué ou falsifié pour la circonstance. Il est clair, ensuite, qu’on crée une forte tentation pour les agents publics qui savent qu’ils ne sont pas autorisés à faire quelque chose (procéder à une sonorisation sans que les conditions en soient remplies, par exemple), à inciter des particuliers intéressés aux faits, voire de simples hommes de paille recrutés pour la circonstance, à faire ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes puis à accepter le dépôt des preuves ainsi frauduleusement obtenues.
La première justification que donne la jurisprudence de la Chambre criminelle à cette position surprenante est que la liberté des preuves doit prévaloir dès lors qu’il n’y a pas de texte en sens contraire et que la réglementation de l’obtention des preuves n’étant prévue et sanctionnée que pour les agents publics et non pas pour les particuliers (on serait tenté d’ajouter « et pour cause » !), la liberté de ceux-ci reste entière dans la recherche et le dépôt des preuves. Le second argument est qu’il appartient à la juridiction saisie de quelque mode de preuve que ce soit d’en apprécier la valeur probante.
En droit, l’argument selon lequel le juge apprécie librement la valeur des preuves peut être immédiatement récusé dans la mesure où la question de l’appréciation de la valeur d’une preuve ne peut se poser que si l’élément de preuve en cause est recevable ce qui est tout le problème ici discuté. En fait, la connaissance d’éléments de preuve, même si le juge du fond les récuse ensuite pour manque de loyauté ou de fiabilité, ne peut pas ne pas exercer une influence sur la formation de son opinion surtout dans un système d’intime conviction et tout particulièrement lorsqu’interviennent des jurés mal formés à faire la différence entre preuves officielles et officieuses. Quant à l’argument tiré de l’absence de réglementation des pouvoirs de recherche des particuliers, il constitue toute la négation de la procédure pénale car on ne voit pas pourquoi on se donnerait le mal de réglementer les droits et obligations des agents publics si d’autres qu’eux peuvent obtenir les mêmes éléments de preuve sans respecter aucune des règles ou restrictions qui leur sont imposées, à eux : quel est l’intérêt de réglementer les perquisitions publiques si les particuliers sont autorisés à voler les éléments qui devraient être saisis ? Si seul le récolement des preuves par les agents publics est réglementé c’est parce qu’il est invraisemblable que l’on autorise de simples particuliers à se livrer à des investigations personnelles et que le Code de procédure pénale n’a donc pas pu le prévoir. Les simples particuliers peuvent participer à la procédure par leurs déclarations. Il ne devrait pas pouvoir être question de les autoriser à se livrer, pendant le cours de la procédure, à des enquêtes forcément partiales et libérées de toute contrainte.
Dans la ligne de sa jurisprudence générale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique naturellement le même principe à la question des enregistrements de conversations téléphoniques, télématiques ou directes. Elle l’a jugé d’abord dans le cas de l’interception par des victimes de persécutions téléphoniques du « corps des délits » au motif qu’entièrement dédié à l’enregistrement d’une infraction pénale ce comportement n’atteignait pas l’intimité de la vie privée. L’argument peut convaincre sur le strict terrain de l’atteinte à la vie privée mais ne répond nullement à l’exigence d’une fiabilité de la preuve qui n’existe pas quand un simple particulier enregistre ce qu’il veut, quand il veut, comme il le veut (ou le peut). Il en est de même de la jurisprudence qui justifie, au nom des droits de la défense, le fait qu’une partie civile se procure illicitement les moyens de cette défense. Qu’est-ce qui garantit que la personne qui produit des éléments qu’elle a appréhendés sans contrôle n’a pas fait un choix dans ceux qui étaient disponibles pour ne garder que ceux qui soutenaient sa thèse ?
La même solution a été ensuite reprise à propos d’une partie civile « enquêtant » en cours de procédure (et qui plus est, à la demande des policiers chargés de l’affaire) et qui produisait l’enregistrement d’une conversation de longue durée avec le suspect pendant, après et peut-être même pendant qu’ils entretenaient des relations sexuelles. Outre le même grief de non-fiabilité (attesté ici par un rapport d’expertise acoustique), l’atteinte à l’intimité de la vie privée était patente.
La même justification par la qualité de victime enregistrant une infraction pénale a été encore retenue par la Chambre criminelle à propos d’un policier ayant enregistré en enquête de police, une conversation qu’il avait eue avec un suspect lui ayant fait des offres de corruption. Si la fiabilité et l’absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée peuvent être ici admises, la justification par la qualité de « victime » est ridicule, la victime d’une infraction de corruption de policier n’étant pas le policier qui n’en est que le moyen mais la collectivité publique.
Enfin, le procédé est aujourd’hui justifié en ce qui concerne des enregistrements réalisés par un tiers « dans l’intérêt » d’une personne qu’il estimait victime d’infractions et qu’il souhaitait défendre, hypothèse qui réunit tous les défauts de la méthode alors surtout que les propos enregistrés étaient une conversation entre un avocat et son client.
Quelles sont, dans ces conditions, les chances pour M. Benalla d’obtenir l’annulation qu’il demande ? Elles sont minces, à moins que la Chambre criminelle ne veuille bien se rendre compte du caractère indéfendable de sa position.
On a pu nourrir quelques espoirs lorsque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a annulé le 7 janvier 2011 une procédure commerciale au cours de laquelle l’une des parties avait obtenu une preuve de manière illicite ; que les chambres civiles ont adopté le même point de vue et que la Chambre criminelle a invalidé le dépôt d’un enregistrement fait par un particulier au motif que les agents publics avaient été associés au mécanisme tout au long de son déroulement. Elle empêchait ainsi la collusion entre des agents publics qui feraient faire par un particulier quelque chose qui n’entre pas dans leurs pouvoirs mais la déloyauté privée pure demeurait admise. Malheureusement, ce qui demeure incompréhensible, un arrêt de 2015 de l’Assemblée plénière statuant en matière de droit privé semble être revenu sur sa position de 2011 et un autre arrêt statuant, cette fois en matière pénale, a affaibli la dernière position de la Chambre criminelle en relevant que les juges du fond sont libres dans leur appréciation sur le point de savoir s’il y a eu ou non collusion entre les agents publics et les particuliers rassemblant des preuves. Enfin le Conseil constitutionnel lui-même est entré dans la danse même si sa décision rendue le 4 décembre 2013 à propos de la loi du 6 décembre 2013 reste ambiguë.
Dans une décision concernant les articles 37 et 39 de la loi 2013 qui autorisent les administrations fiscales et douanières à exploiter toutes les informations qui leur parviennent, même si elles sont d’origine illicite, le Conseil a formulé une réserve d’interprétation disant que cette possibilité ne sera pas ouverte quand les pièces ou documents concernés auront été obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge. Cela semble confirmer que la fraude commise par un particulier est considérée comme normale du point de vue probatoire. Mais d’un autre côté, la même décision a annulé les articles 38 et 40 de la même loi qui autorisaient les mêmes administrations à se prévaloir de documents illicites pour solliciter du juge un droit de perquisition sans distinguer selon que l’origine illicite était imputable à l’administration ou à un particulier ce qui laisse subsister une marge de doute.
En clair (si l’on peut dire) la jurisprudence de la Chambre criminelle considère que l’illégalité et donc la déloyauté d’une preuve n’altère pas la force probante de l’élément fourni dès lors qu’on est certain qu’il n’émane pas d’agents publics et cela quelles que soient les autres circonstances de l’appréhension de cet élément.
Mais on trouve dans la jurisprudence des autres formations de la Cour et du Conseil constitutionnel des décisions qui contredisent cette jurisprudence.
Le moment n’est-il pas venu pour la Chambre criminelle de se rendre compte que sa position n’est pas défendable ?